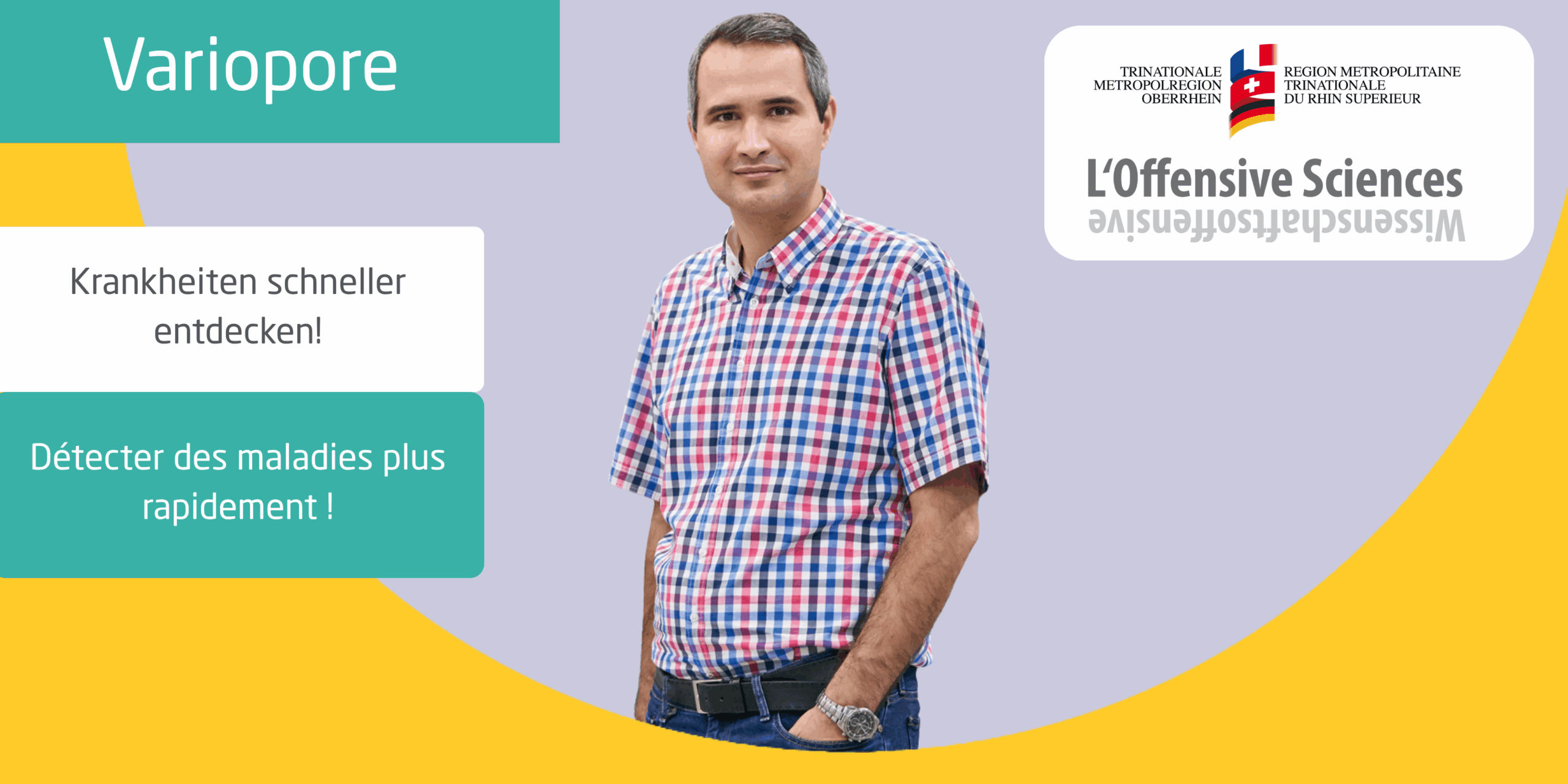Le projet VarioPore apporte une innovation dans le domaine du diagnostic médical : la détection de molécules à l’aide d’un nanopore afin de réaliser des tests rapides sur le lieu de soins. Cette innovation est développée par un consortium trinational composé de la Hochschule de Furtwangen, de l’Université de Haute-Alsace et de la Fachhochschule Nordwestschweiz. Les chercheurs collaborent avec des partenaires médicaux et industriels afin de développer et de tester cette technologie révolutionnaire d’appareils de diagnostic mobiles pour des tests plus rapides et plus fiables sur le lieu de soins. Le Pilier Sciences s’est entretenu avec le porteur de ce projet financé dans le cadre de l’Offensive Sciences, qui nous a présenté la genèse du projet, l’expertise des équipes de recherche et les avancées que cette technologie apportera aux laboratoires et aux patients.

Pouvez-vous vous présenter brièvement et décrire votre rôle dans le projet VarioPore ?
Je m’appelle Bahman AZARHOUSHANG, je suis directeur du KSF – Institute for Advanced Manufacturing de la Hochschule de Furtwangen et coordinateur scientifique du projet VarioPore.
Comment l’idée de VarioPore est-elle née et que développez-vous dans le cadre de ce projet ?
L’idée est née pendant la pandémie de coronavirus. À cette époque, il est apparu clairement qu’il était essentiel de détecter rapidement les maladies potentielles. Lorsque nous avons pris connaissance de l’appel à projets de l’Offensive Sciences, l’occasion s’est présentée de développer une technique de diagnostic rapide et mobile basée sur les nanopores. La première application devait être la détection de la borréliose. Cette maladie est transmise par les tiques, ce qui rend le projet particulièrement pertinent pour la région du Rhin supérieur.
Quelle est la technologie derrière VarioPore ?
Tout d’abord, on creuse un trou dans un morceau de céramique de manière à ne laisser qu’une couche très fine, appelée membrane. Elle est à peu près aussi épaisse que la peau d’une bulle de savon. Un trou extrêmement petit est ensuite percé dans cette membrane. Son diamètre n’est que d’un millième de cheveu humain. On appelle ces trous des « nanopores ». Les agents pathogènes tels que les virus ou les bactéries peuvent passer à travers ces nanopores. Si l’on applique une tension électrique entre la face supérieure et la face inférieure de la membrane, chaque agent pathogène génère un courant spécifique. On obtient ainsi une sorte d’empreinte digitale de chaque virus et de chaque bactérie.
Les bactéries et les virus peuvent avoir des tailles très différentes. Le diamètre des nanopores doit donc être choisi en conséquence. Dans le cadre de ce projet, nous développons une méthode permettant d’adapter de manière flexible la taille des nanopores. Cela rend les analyses réalisées avec cette méthode non seulement rapides, mais aussi peu coûteuses. Un même nanopore peut être utilisé pour détecter plusieurs agents pathogènes.
Plusieurs partenaires universitaires de la région du Rhin supérieur participent au consortium de votre projet. Quelles sont les compétences apportées par chaque établissement ?
À la Hochschule Furtwangen (KSF), nous développons les procédés permettant de fabriquer les membranes minces. Pour cela, nous utilisons un laser. Les nanopores sont ensuite percés dans les membranes. Il existe deux méthodes pour cela : la première utilise en quelque sorte une étincelle électrique pour créer un nanopore, l’autre un microscope électronique spécialement équipé.
À la Fachhochschule Nordwestschweiz, les membranes et les nanopores de grande taille sont fabriqués à l’aide d’un procédé d’impression 3D. Cela présente l’avantage de pouvoir créer non seulement des nanopores ronds, mais aussi d’autres formes telles que des fentes, ce qui pourrait faciliter la détection de certains agents pathogènes.
À l’Université de Haute-Alsace, des plastiques spéciaux sont développés pour recouvrir les surfaces des membranes et des nanopores. Cela permet notamment d’adapter leurs propriétés électriques.
Tous ces développements sont regroupés à l’Institute of Precision Medicine (IPM) de la Hochschule Furtwangen. C’est là que l’appareil de diagnostic est fabriqué et que les tests sont effectués.
Quel est pour vous l’avantage de développer ce projet avec des partenaires de la région frontalière et, inversement, quelle est la valeur ajoutée de votre projet pour le Rhin supérieur ?
Le fait d’avoir trouvé les bons partenaires à proximité est un avantage indéniable. Chacun apporte au projet l’expertise scientifique, l’expérience et l’équipement nécessaires. La coopération permet également de mieux se mettre en réseau, ce qui facilite le lancement d’autres projets communs. De plus, il est toujours intéressant pour les chercheurs de découvrir comment se déroulent les recherches dans d’autres établissements d’enseignement supérieur.
L’objectif du projet est de développer une méthode rapide et peu coûteuse de détection des maladies. Cela profitera à tous les habitants de la région du Rhin supérieur, mais aussi au-delà. Grâce à une meilleure mise en réseau, le projet contribue également à renforcer la coopération en matière de recherche dans la région du Rhin supérieur. Il s’agit là d’un avantage concurrentiel évident, car cela favorise l’innovation.
Le projet VarioPore est un projet de l’Offensive Sciences de la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur, cofinancé par le programme Interreg Rhin supérieur, la Région Grand Est, le Ministère des Sciences, de la Recherche et des Arts du Land de Bade-Wurtemberg et le Ministère des Sciences et de la Santé du Land de Rhénanie-Palatinat. La Confédération suisse et les cantons du nord-ouest de la Suisse participent au financement des partenaires suisses du projet.
Plus d’informations : https://www.hs-furtwangen.de/en/research/research-projects/variopore